Frankenstein, quel est ce variant du covid dont on parle ?
Le nouveau variant du SARS-CoV-2 surnommé « Frankenstein » intrigue autant qu’il inquiète. Officiellement appelé XFG, il circule activement depuis plusieurs semaines et a été classé sous surveillance par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Devenu majoritaire dans plusieurs pays, dont la France, il suscite de nombreuses interrogations. Que sait-on vraiment de ce sous-variant d’Omicron ? Provoque-t-il plus de formes graves de Covid-19 ? Et comment s’en protéger ? On fait le point sur les dernières données scientifiques.
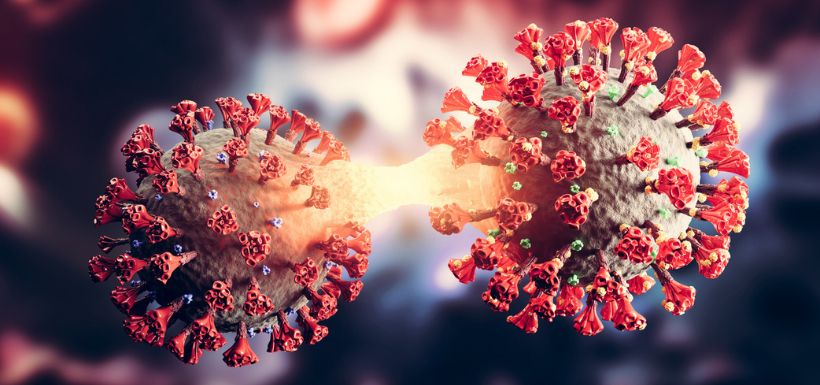
XFG, alias « Frankenstein » : un sous-variant d’Omicron sous surveillance
Le variant XFG est issu d’une recombinaison de deux lignées d’Omicron. Cela lui a valu le surnom de « Frankenstein », en référence au célèbre monstre constitué d’un assemblage de corps.
Les analyses publiées par l’OMS indiquent plusieurs mutations au niveau de la protéine Spike. C’est cette partie de l’enveloppe du virus qui lui permet de pénétrer dans les cellules humaines. Elles pourraient favoriser un meilleur contournement des anticorps, rendant la transmission plus aisée.
Toutefois, les experts se veulent rassurants : aucune donnée ne montre une sévérité augmentée des formes de Covid-19 dues à ce variant. Les infections restent majoritairement bénignes ou modérées, surtout chez les personnes vaccinées.
L’OMS précise également que les vaccins actuels conservent leur efficacité, en particulier contre les formes graves et les hospitalisations. Les campagnes de rappel restent donc pertinentes, notamment pour les personnes les plus vulnérables : plus de 65 ans, femmes enceintes ou personnes immunodéprimées.
Des symptômes similaires, avec quelques particularités
Les symptômes du variant XFG sont proches de ceux des précédentes versions d’Omicron :
- Fièvre ;
- Maux de tête ;
- Toux ;
- Écoulement nasal ;
- Fatigue
- Courbatures.
Mais certains médecins observent une atteinte plus marquée de la gorge. L’enrouement serait l’un des signes distinctifs du variant Frankenstein. L’inflammation locale, provoque une voix rauque ou éraillée
Dans la majorité des cas, ces symptômes restent légers à modérés et disparaissent en quelques jours. Comme le rappellent les professionnels de santé, le dépistage demeure le seul moyen de confirmer une infection, les signes cliniques seuls ne suffisant pas à la distinguer des autres infections respiratoires saisonnières.
À retenir : le variant Frankenstein en bref
- Nom scientifique : XFG (ou Stratus)
- Famille : sous-variant d’Omicron
- Mutations clés : protéine Spike (positions 478 et 487)
- Contagiosité : supérieure aux variants précédents
- Gravité : similaire, formes généralement modérées
- Vaccins : toujours efficaces contre les formes graves
Une hausse modérée des cas de Covid en France
En France, les indicateurs de surveillance montrent une hausse modérée des infections au SARS-CoV-2 depuis la rentrée. D’après le dernier bulletin de Santé publique France, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont augmenté en particulier chez les plus de 75 ans (+24 %).
Le réseau Sentinelles, qui regroupe les données de médecine de ville, observe lui aussi une recrudescence des infections respiratoires aiguës, dont le Covid-19 avec 33 000 nouveaux cas estimés. Cette tendance correspond à un schéma saisonnier désormais bien établi, semblable à celui de la grippe : le virus circule toute l’année, mais connaît des pics à l’automne et en hiver.
Les autorités sanitaires insistent sur plusieurs points :
- La circulation du virus reste maîtrisée, sans signe de reprise majeure.
- Les formes graves sont beaucoup moins fréquentes, grâce à l’immunité collective (vaccination et infections passées).
- Le maintien de la vaccination et des gestes barrières (aération, lavage des mains, port du masque en cas de symptômes) reste essentiel, surtout pour les personnes à risque.
Selon l’Institut Pasteur, les chercheurs observent désormais des vagues saisonnières prévisibles, comparables à celles de la grippe. Le SARS-CoV-2 tend à s’inscrire dans une circulation de fond, marquée par des hausses ponctuelles, moins intenses et moins graves qu’au début de la pandémie. Néanmoins, la surveillance épidémiologique reste essentielle pour suivre l’évolution des variants et ajuster les stratégies de prévention.
Cet article vous a-t-il été utile ?