Froid et sport : comment adapter son activité physique à la baisse des températures
Quand les températures chutent, le corps réagit différemment : les muscles se raidissent, les tendons se fragilisent et le risque de blessure augmente. Le Dr Michel Gaillaud, médecin du sport à Cannes, explique comment continuer à bouger sans danger en hiver.
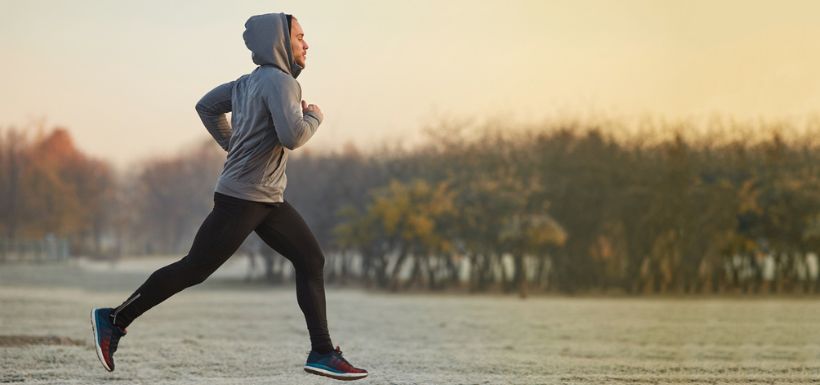
Quand la température descend, le corps se met en mode survie. « Le froid provoque une vasoconstriction, c’est-à-dire que le sang est redirigé vers les organes nobles – le cœur, les poumons, le cerveau – au détriment des muscles et des tendons », explique le Dr Michel Gaillaud. Résultat : une moindre irrigation, une perte d’élasticité du collagène et un risque accru de blessure.
Les muscles répondent moins vite et les gestes deviennent moins précis. « Le froid provoque une sorte de ralentissement du système nerveux, ce qui diminue la coordination et les réflexes », ajoute-t-il. Conséquence : les entorses, contractures, déchirures ou douleurs lombaires sont plus fréquentes.
Le risque n’est pas seulement musculaire. « Chez les plus de 50 ans, le froid peut aussi favoriser des pathologies cardiaques — infarctus, angine de poitrine — car le cœur doit fournir davantage d’efforts pour maintenir la circulation sanguine », alerte le médecin. Prudence donc, surtout lors des efforts intenses ou en début de journée.
Bien s’échauffer, s’hydrater et s’équiper
Face à ce stress thermique, trois réflexes s’imposent : l’échauffement, l’hydratation et l’équipement.
« L’échauffement, ce n’est pas trois minutes en levant les genoux. Il doit durer au moins un quart d’heure, avec des mouvements dynamiques », souligne le Dr Gaillaud. Il recommande les étirements activodynamiques, qui associent étirement et contraction musculaire : « C’est ce qui prépare le corps à répondre aux contraintes du froid. En dessous de quinze minutes, on se met en difficulté. »
Autre piège : l’hydratation. « Dans le froid, on n’a pas soif. Pourtant, le corps continue à perdre de l’eau. Quand on commence à ressentir la soif, c’est déjà trop tard. » Il conseille donc de boire avant, pendant et après l’effort. L’alimentation doit aussi apporter suffisamment de glucides, véritable carburant du muscle.
Côté tenue, la règle des trois couches reste de mise : une première respirante, une deuxième isolante et une troisième coupe-vent. Sans oublier les extrémités. « Il faut protéger les mains, la tête et les voies respiratoires, par exemple avec un cache-cou ou un masque léger, pour éviter d’inhaler un air trop froid. »
Le bon moment pour s’entraîner
Notre corps ne réagit pas de la même façon selon l’heure de la journée. « Il existe une chronobiologie du sport. Les performances, mais aussi la résistance, sont meilleures entre 17 h et 19 h », indique le Dr Gaillaud.
Le matin, l’organisme est encore en “phase de réveil”. « Faire du sport à 6 h, c’est le pire moment : les muscles sont froids, les réflexes ralentis et les risques de blessure multipliés. »
Sous les 5 °C, la régulation thermique atteint ses limites. « L’hypothalamus, notre thermostat biologique, tente de maintenir le corps à 37 °C. En dessous de 5 °C, le système peine à suivre », précise-t-il. Le corps doit alors produire plus de chaleur — c’est la thermogénèse —, ce qui augmente la fatigue et complique la récupération.
Après l’effort : récupérer et surveiller les signaux
« La récupération est très hydrique et très glucidique », insiste le médecin. Boire, se couvrir immédiatement, consommer un encas riche en glucides : autant de gestes simples pour éviter les coups de froid et les douleurs musculaires.
En cas de gêne persistante, mieux vaut ne pas attendre. « S’arrêter quinze jours sans consulter n’est pas la bonne solution. Une lésion mal prise en charge cicatrise mal et récidive souvent. »
Un examen par échographie permet d’évaluer l’étendue de la blessure et de suivre sa guérison. Pour les tendinites chroniques, certaines techniques de régénération tissulaire comme le PRP (Plasma Riche en Plaquettes) peuvent être proposées. « Le PRP, c’est l’auto-réparation : on concentre les éléments réparateurs du sang pour stimuler la cicatrisation. C’est un traitement 100 % physiologique, sans ajout de produit extérieur. »
Le sport, un “médicament” à ne pas abandonner
Même en hiver, l’activité physique reste un allié de santé majeur. « Le sport, c’est un médicament », aime rappeler le Dr Gaillaud. « C’est un anti-burn-out, un anti-stress, un optimiseur des fonctions cognitives et un soutien des maladies chroniques. »
En respectant les bons gestes — s’échauffer, s’hydrater, se couvrir, écouter son corps —, le froid ne doit pas être un frein à la pratique. « Le corps est une formidable machine d’adaptation », conclut-il. « Encore faut-il lui donner les bonnes conditions pour fonctionner. »
Cet article vous a-t-il été utile ?
